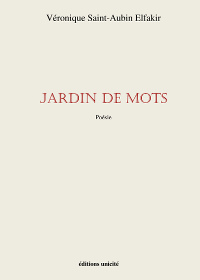Revue Terre à ciel
Dans les sentiers du verbe : Les poèmes jardins de Véronique Saint-Aubin Elfakir
Il y a deux manières d’entrer dans un jardin : en franchir la grille principale, ou passer par un portillon latéral caché. Tentons cette expérience avec Jardin de mots que Véronique Saint-Aubin Elfakir a tout récemment publié aux Éditions Unicité. Commençons par le seuil : « Il y a ce poème,/ Jardin où tu touches terre,/ le peuplier d’un mot dévoile/ Son allée incertaine,/ Il y a cet éclair de l’instant/ Dans la chute d’un fragment. » (p.9). D’emblée, le poème est jardin, d’emblée il est cet « il y a » du toujours absolu, vivant instant d’intemporel que disent les mots entrelacés à l’expansion du végétal. Tout est donné comme une offrande en évidence, parole et jardin s’accordant au « tu » qui en reçoit le don et reconnaît cette vérité première. Liant le vertical aux sinuosités du sol par l’ « allée incertaine » - qui est autant celle du feuillage ascensionnel (j’allais dire flamme ou rivière) qu’un vrai chemin de terre, « le peuplier d’un mot » ouvre ce livre d’un dévoilement premier. Si le peuplier est un mot, le « jardin où tu touches terre » désigne aussi bien la réalité de l’humus nourricier qu’un asile spirituel déployé dans le langage. Aussi, le jardin verbal de Véronique Saint-Aubin Elfakir est-il aussitôt le lieu d’un retour et d’une naissance, l’ « allée incertaine » dessinant le mouvement d’une pensée sensible qui s’improvise pas à pas. L’éclair de l’instant, le fragment venu par sa chute, sont les révélations qui en résultent. Ce double dévoilement de l’allée et de l’instant, même par le léger déséquilibre de l’incertain et de la tombée, ou justement grâce à lui, est déjà forme d’un accomplissement. Le poème peut alors poursuivre son chemin d’éclosion : « Tu prends langue/ Au cœur des fleurs, rouges pivoines/ D’un désir épanoui./ Il y a cette tempête/ De langage/ Où tu cultives l’incertain. », (p.9). La voix inaugurale prend « langue » comme une plante ses racines, et c’est au centre flamboyant des pivoines et du désir que s’effectue cette incarnation, la langue étant effectivement chair autant que vibration. Le jardin du poème est donc pur devenir de l’éros verbal qui veut en lui la floraison. Il se gonfle de ses deux substances étroitement unies qui le font à la fois maison naturelle et cosmos de mots. Cette unité en miroir se laisse d’ailleurs lire dans la disposition même du texte où ne cessent de s’appeler et de se répondre les doubles, comme si poème et jardin se reflétaient l’un en l’autre. Ainsi, la formulation inaugurale « Il y a » ou l’adjectif incertain, deux fois donné, au féminin puis au masculin, comme si Yin et Yang, implicitement, s’y laissaient deviner. Et la plus belle fleur, précisément cultivée par le « tu » s’adressant à lui-même, est justement d’incertitude. Rien n’est jamais entièrement donné qui ne soit un pari, un risque assumé du poème en son jardin.

J’ouvre maintenant le livre à son milieu approximatif et accueille ce qui provient de ce hasard : « Juste un instant de l’être…/ Sur un parchemin de nature déroulée/ Un rêve de pierre et de feuilles sèches/ Comme un koan secret » (p.37). Comme toujours, le hasard fait bien les choses, puisque ce poème figure deux fois dans l’ouvrage : au centre et sur sa bordure extérieure, en quelque sorte de l’autre côté de son mur de clôture, dans la quatrième de couverture où il apparaît en qualité d’emblème de l’ensemble. Bien qu’il soit quatrain, mais un quatrain très bref et laconique, il a presque la forme d’un haïku dont il possède aussi l’étrangeté immédiate en sa simplicité, et c’est peut-être une des raisons pour lesquelles il est répété en deux lieux différents du livre. Avec lui, le jardin se réduit à l’essentiel : quelques signes et quelques formes sèches où la nature est support d’écriture, songe minéral et végétal d’automne ou d’hiver, sans la luxuriance des pivoines (au demeurant si souvent présentes elles aussi dans la poésie japonaise). Ce rêve parchemin reçoit une empreinte, celle d’un simple « instant d’être », moins qu’un signe d’écriture, ou plus, dans une sublimation de tout tracé et de toute parole, les mots rémanents du texte qui en fixent la présence se résorbant dans celle-ci par le « il y a » implicite de ce presque mantra, à peine prononcé mentalement. Le poème se limite au très peu d’éléments qui le constituent et le soutiennent, sur la lisière de l’immatériel, à la manière des koans, ces énigmes zen qui possèdent l’aptitude, par leur sidérant mystère, de stimuler l’éveil. Mais c’est ici un koan au second degré puisqu’il se renforce d’un secret. Faut-il entendre une énigme dans l’énigme, comme un infracassable noyau d’indicible ? Un koan plus énigmatique que tous les autres ? Un koan caché au centre du poème et dont seule la forme pure, évidée par le nom, manifeste la substance ? Ou bien, l’équivalent non verbal d’un koan donné dans la seule apesanteur de l’instant ? L’être lui-même, soudain réverbéré dans la sobriété de la langue, en quelques vers évasifs ? Tout cela sans doute, mais, selon la logique des koans, de façon flottante que n’épuise nulle solution.
Le poème, en tout cas, est toujours patience d’un double chemin dans le frémissement du sensible et la très fine trame ontologique du monde : « Sur un sentier de vocables/ L’intensité d’un être au monde// Cueillir l’apparition// Le mot est une fleur// L’immensité du nom/ Un morceau de ciel » (p.19). De nouveau, le texte se réduit à l’essentiel, laissant habiter le vide et résonner par lui chacune des devises qu’il formule, affirmations d’être, préceptes, définitions, comme les atomes d’une sagesse révélée par visions successives, encouragées les unes par les autres et simultanément autonomes comme des pétales à la surface de l’eau qui les emporte - mais non pas vainement car un trajet se tisse qui va du « sentier de vocables » à « Un morceau de ciel ». Tout à l’heure, la méditante touchait terre, et maintenant, elle s’élève graduellement vers l’immense, dans un double mouvement d’ouverture et d’accueil, si bien que l’espace et le fragment viennent s’ajuster l’un à l’autre. Au milieu est le mot fleur, non au sens mallarméen d’ « absente de tout bouquet », tout au contraire dans la mesure où ce mot participe justement de la nature fleur, tout comme la langue s’incarnait déjà dans les pivoines. Il est une éclosion, un cosmos complet, une expansion unifiée à partir de son centre (faisant aussi songer à l’ouverture d’un éventail, l’une des figures symboliques récurrentes de l’ouvrage), et c’est pourquoi il donne accès par le « nom immense » au tesson de ciel prélevé dans l’étendue illimitée de l’azur. On ne peut manquer de remarquer que cette assomption dans l’être suit une courbe de valorisation linguistique des simples « vocables » jusqu’au « nom » en passant par le « mot », comme si se révélait et se disait graduellement le pressentiment d’une présence. A l’image du jardin, qui est en soi totalité rassemblant l‘infini monde dans sa clôture, le poème détient l’immense par le fragment. On songe à la pensée dont toute l’ambition, selon le philosophe Gilles Deleuze, est de rapporter dans ses filets un petit morceau de chaos, mais ici, il ne s’agit pas de capturer la réalité tumultueuse des phénomènes dans les mailles des concepts. On devine que le poème ne dispose ses mots que dans le but bien plus profond de refléter et d’être, d’accorder son effort d’expression à la vie pure et de se laisser devenir en elle pour mieux atteindre sa propre vérité changeante.

Cette vertu participative explique pourquoi l’écriture poétique de Véronique Saint-Aubin Elfakir épouse si aisément les formes mouvantes du monde. Entre elle et lui se glisse bien plus qu’un jeu analogies. L’errance d’exister dans le scintillement spirituel de l’écriture et les métamorphoses élémentaires qui ne cessent de traverser les présences sensibles sont les deux faces d’une même réalité où se joue le mystère de l’être : « Des volutes de phrases aux éclats incertains/ Déambulent sous le ciel/ Dans le vacillement des mots/ Paysage de sable et de roches » (p.23). Comme le précise la présentation du livre en quatrième de couverture : « Les mots ici tentent d’exprimer l’indicible qui est l’essentiel pour renaître au monde. Peu à peu le lecteur éprouvera pleinement que c’est dans le ressenti que tout se dévoile, que prend forme le langage comme un chemin de connaissance vers soi. » L’intime et la chair du monde sont en effet liés par cet appel. Le même poème se poursuit d’ailleurs par ces vers d’affirmation fragile : « Cette terre poétique vaste/ Lacunaire/ Brisée/ Comme ce corps désirable de l’amour/ Dans le blanchissement du temps » (p.23). A nouveau se dialectisent l’immense et le ténu, mais cette fois par l’intermédiaire du manque, de la fragmentation et de l’insurmontable dualité à l’image de celle des corps et des êtres. La parole oscille entre l’expérience de l’expansion poétique inhérente à la terre, et l’usure temporelle qui blanchit d’avance le corps de l’amour, si bien que le mouvement d’amplification cosmique s’accompagne d’un extrême sentiment de solitude et de précarité. Le poème s’efforce d’unir et de faire renaître les éléments du monde, sans obtenir, une fois encore, de certitude, comme on le lit en filigrane dans les derniers vers : « Lapidaires lueurs/ Blessures recousues/ Sous l’incantation/ Verbale de la vie/ Mousse herbe chant/ Abandon… » (p.23). Au lieu du jardin floral qui lui donnait sa pulsation rouge, le poème, devenu chant d’invocation et de conjuration, s’identifie désormais aux plus modestes formes de la vie végétale, mais aussi les plus tenaces : la mousse et l’herbe. En territoire d’abandon, ne faut-il pas ces vies patientes et minuscules qui en dépit de tout continuent de s’exalter ? Même là où l’incertain gouverne et semble céder la place au vide, demeurent pourtant cette herbe chant et cette mousse poétique qui évoquent à la fois les jardins secs des temples japonais et les espaces désolés des régions nordiques ou des hautes montagnes isolées. Des « Lapidaires lueurs » à l’ « Abandon », le poème dit cet ostinato menacé qui ne cesse pourtant de lancer son signal, comme un phare dans le brouillard.

Cependant, « Il suffirait d’une tige/ D’un presque rien/ Comme une porte d’entrée » (p.31) pour que poème et vie redeviennent possibles. La germination et la croissance de l’être végétal le plus mince est déjà promesse de tout un jardin dont le seuil s’ouvre d’avance. En effet : « Des vacillements du monde/ Surgit un poème tremblant/ Suturant la faille des jours/ Un chemin d’herbes folles/ Tous ces clairs obscurs/ De la route » (p.27). Le poème est à la fois un acte guérisseur et le libre tracé exubérant d’une nature restaurée. Il en épouse intimement les cycles et la substance, lui donne son axe et la rend à sa vocation première de jardin où le sens redevenu mouvement est vivante ouverture : « Un bourgeon surgit soudain de la blancheur/ De la page/ et tout recommence… » (p.27). De fait, le livre tout entier se fait jardin bruissant que le lecteur peut explorer, où l’émotion le gagne de page en page quand soudainement il assiste à cette renaissance : non plus seulement la ferveur d’un espoir, mais le don miraculeux d’un bourgeonnement. La blancheur initiale de la page est donc parfait silence permettant cette métamorphose, mais aussi, de manière presque invisible, délicate allusion au passage de l’hiver au printemps.
Délicatesse est bien le maître mot de ces poèmes dont les vides ne sont pas toujours signes muets de blessures et de manques. Ils apportent aussi les intervalles d’une pure transparence aérienne où se déploient finement les présences et les mots : « Les bouleaux blancs se balançant/ Dans le vide/ La balafre d’une hirondelle / Dans le ciel » (p.29). Ici, c’est l’oiseau véloce qui est balafre dans l’espace d’un ciel que son rejet au dernier vers laisse immense et intact. Ainsi comprise, l’entaille de l’oiseau est davantage la fulgurance d’un signe qu’une simple déchirure. Le fait est que la balafre n’incise le temps que pour restituer sa place à une mémoire conjurant la perte, plutôt que pour meurtrir : « Quelques silhouettes sépia/ Qu’une soudaine musique fait ressurgir/ L’écho de mille pertes/ Dans l’isba de l’enfance/ La mémoire est un éventail d’argent/ Qui fige le temps/ Le souvenir est l’onguent de nos solitudes » (p.29). La grâce de ce poème est que nous n’en saurons pas davantage. Quelques traces à peine posées à la surface du langage, impondérables et mystérieuses, comme doit l’être le souvenir quand il revient sur la paume du temps soulager l’âme du fardeau présent qu’elle affronte. Tout vient de loin, non d’un jardin cette fois, peut-être d’une forêt, et bien sûr d’une maison, mais irréelle par son nom d’isba qui nous emporte à lui seul vers un monde magique évocateur des contes et des légendes de notre prime jeunesse, un pur emblème universel de l’asile, comme la maison des musiciens de Brême où toutes celles, rêvées ou jouées, qui habitent encore en nous, à l’instar de la maison natale de Pierre Seghers : « Un nom que le silence et les murs me renvoient,/ Une maison où je vais seul en appelant/, Une étrange maison qui tient dans ma voix/ Et qu’habite le vent » (Le Temps des merveilles, Editions Seghers). Dans le poème de Véronique Saint-Aubin Elfakir, ce n’est pas une voix qui s’élève, mais une musique faisant « écho de mille pertes ». Qu’elle soit maison natale où le poète déambule en appelant une âme tutélaire, ou bien « isba de l’enfance », la maison des origines, réelle ou imaginaire, est toujours une absence capable de hanter durablement. Mais celle de Véronique Saint-Aubin Elfakir est aussi un « onguent » appliquant sa vertu cicatrisante aux béances de la vie. La fin de ce poème confirme la métaphysique de la délicatesse de manière particulièrement subtile : « Cela fut comme un matin/ Irrévocable/ L’existence, Un labyrinthe de signes/ Des taches de lumière/ A glaner/ Motif infini d’un tissage délicat ». Les êtres et les présences sont en effet à peine disposés à la surface infinitésimale de la parole. Un par un, ils participent du « tissage délicat » de celle-ci, donnant à la poésie cette légèreté de membrane translucide capable de capter les souffles, les gouttes et les reflets, d’unir tous les dédales du sens aux floraisons de l’être.

C’est pourquoi les mots participent d’une double nature florale et évidée - mais d’une façon toute substantielle qui leur donne profondeur et densité : « L’iris d’un mot/ Comme une entaille de couleurs/ Pupille d’un regard ouvert/ Sur l’horizon », (p.35). On observera qu’une fois encore, au lieu de longues périodes lyriques, Véronique Saint-Aubin Elfakir préfère poser un à un quelques noms, comme des pétales ou des baies formant au sol ou sur l’eau d’un bassin une composition calligraphique éphémère. Ce qui n’empêche nullement dans le même poème que la pupille du mot soit aussi « Passante d’un étrange printemps/ Au bord du fleuve du langage », ni que « L’émotion palpite ». Délaissant tout effet rhétorique, la tresse de langage préfère jouer d’échos à distance pour constituer ce courant verbal, notamment par des jeux d’allusions, comme celles qui conduisent de « L’iris d’un mot » à la « Pupille d’un regard ouvert », pour s’ouvrir à la fin du poème sur l’ensemble d’un visage : « Syllabes en partance/ Le reflet d’un instant sur un visage/ Déployé. » Comme l’iris initial, le visage est fleur épanouie. Son unité provient d’un mot voyant aux vertus chromatiques et émotionnelles, capable de fixer le devenir universel en cette expansion parfaite qui relie le poème à lui-même. Ailleurs, le pouvoir des mots permet qu’un autre visage issu du passé se reforme et reparaisse : « Un visage effiloché par le temps/ Surgit/ Au détour d’un sentier », (p.45). Souvent, on le remarque par exemple dans ces deux poèmes, Véronique Saint-Aubin Elfakir isole un mot nodal à l’instant précis de son exacte radiance dans la trame de la parole. C’est le cas du participe passé « Déployé » qui vibre presque comme un substantif dans la stase d’épanouissement final qu’il donne au poème. C’est également le cas de « Surgit » dont se trouve de cette façon renforcée et soulignée l’essence d’apparaître soudain. L’art d’être jardin est bien là, en ces éclosions subites qui font de l’ensemble du recueil un livre des manifestations infinies, sans cesse relancées dans l’aventure du langage : « J’écris pour capturer/ Le souffle de l’instant/ Je suis redevable à chaque mot prononcé/ D’une somme d’existence/ J’écris/ Cet éventail entre vide et présence/ Ce paravent d’ombres et de lumières/ De l’existence », (p.65).
Texte, photographies et œuvres éphémères in situ au Parc de la Tête d’Or de Lyon :
Marc-Henri Arfeux